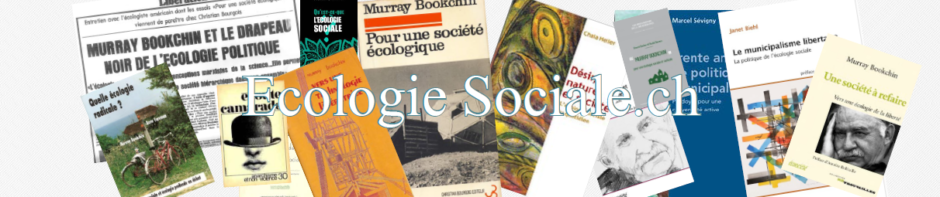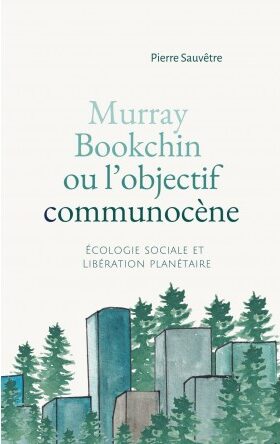
On a vu ces dernières années les traductions de textes de Murray Bookchin se multiplier, auprès de plusieurs éditeurs. Un projet éditorial qui a permis une meilleure diffusion de sa pensée dans l’espace francophone. Ce qui en revanche s’est montré moins présent, c’est une analyse plus précise de sa pensée. Dans cet esprit, le texte de Pierre Sauvêtre est le bienvenu. Loin d’être une nouvelle vue d’ensemble de l’écologie sociale, l’auteur propose de creuser les idées mises en avant par l’écologie sociale et d’enrichir ses principes d’autres visions, en particulier de la théorie des communs.
En sept sections thématiques, Pierre Sauvêtre dresse un panorama complet de l’écologie sociale. « Théorie », « Territoire », « Histoire », « Politique »,… : chaque chapitre représente une approche précise et complète d’un des volets d’étude de l’écologie sociale. Un découpage qui permet de s’y repérer pour qui souhaiterait approfondir ses bases dans un volet précis. Un choix qui laisse aussi entrevoir les liens existants entre chacune de ses dimensions, pensées conjointement.
Les premiers chapitres, « Objectif » et « Théorie », reviennent sur la portée philosophique de l’écologie sociale. Bien que complexes dans leur approche du sujet, ils sont primordiaux car ils traitent d’aspects de sa pensée aujourd’hui plutôt laissés de côté. On retient surtout aujourd’hui les implications concrètes et politiques donc ce rappel des fondements philosophiques renvoie avec raison au spectre plus large des fondements de l’écologie sociale. Sauvêtre revient sur la place de l’écologie sociale au sein du débat autour de l’anthropocène (et des autres propositions de termes qui ont émergé ces dernières décennies pour qualifier le nouvel âge écologique vécu), en évoquant les arguments de Bookchin dans les débat autour de la question du biocentrisme et de l’anthropocentrisme. Au-delà de ce que peut cacher le terme « d’anthropocène », il s’agit pour l’écologie sociale de rappeler le lien intime entre l’être humain et son environnement naturel, et que la vie façonne autant la nature qu’elle s’adapte à elle. La crise, finalement, vient beaucoup de cette opposition entre société et nature et de l’impossibilité de considérer les deux ensembles, comme un tout interdépendant.
Suivent les chapitre « Territoire » et « Économie », qui décrivent en détails le projet décentraliste défendu par Bookchin dès ses premiers textes. On est au cœur de son écologie sociale. L’auteur y décrit sa critique des villes et de leur gigantisme, tout comme celle des technologies induites par cette vision de la société. Avec, à la place, le projet de création de communes et la mise en place d’une économie municipalisée. Le chapitre sur l’économie permet à Pierre Sauvêtre d’amener le principe de « commonalisme », terme fusion entre le communalisme et la réflexion autour de l’économie des communs (de commonisme, « qui renvoie au mouvement de construction d’une économie socialiste des communs […] ces espaces autogouvernés et autogérés, non-hiérarchiques et solidaires de production de biens et de services », p.184.). L’idée étant d’asseoir l’économie municipalisée en premier lieu sur la gestion commune des biens de première nécessité (santé, éducation, logement, alimentation, transports, et les services publics de manière générale) et de substituer, dira Sauvêtre, l’assemblée communale aux conseils communaux actuels, « car la double appartenance des habitants à l’assemblée communale et aux communs municipaux leur garantit le plein droit à l’autogouvernement et à l’usage des biens publics que restreignait jusqu’ici le pouvoir souverain de la municipalité. » (p.309)
Ce lien entre communalisme et économie des communs mérite qu’on s’y arrête, car il est l’un des éléments centraux du livre. Sur le fond, il faut donner du crédit à Pierre Sauvêtre pour son propos. La démarche consistant à enrichir l’écologie sociale d’autres théories « sœurs » et parfaitement compatibles avec elle est une bonne approche. On reste bien dans une continuité avec les perspective avancées par Bookchin, que la perspective des communs vient à mon sens préciser avec justesse. Il faut ajouter à cela une analyse pertinente qui affirme que si un changement économique radical doit avoir lieu, avec une prise en main démocratique de l’économie comme le souhaite l’écologie sociale, il est avant tout nécessaire de parvenir à assurer la gestion des biens essentiels que représentent les communs. Sans quoi les écologistes sociaux « risquent […] de se retrouver désemparés sur le plan économique quand bien même ils parviendraient à mettre en place la réalité concrète de la démocratie directe communale. » (p.187) Un élément clé important de pointer.
En effet, la gestion économique par l’assemblée communale a souvent été pointée du doigt par les critiques de Bookchin et représente probablement un des points, si ce n’est faible, du moins pas assez développé, de sa théorie. Il s’agit pourtant d’avoir des réponses claires et précises à apporter à cette question de transition économique dans la perspective envisagée de sortie du capitalisme. La piste présentée par Pierre Sauvêtre est à ce titre pertinente et fait sens.
Sur la forme en revanche, je crains que l’ajout au lexique militant du terme « commonalisme » (tout comme le « communocène » repris en titre de l’ouvrage) ne brouille plus les pistes qu’il ne les éclaircisse. Objectif louable, mais pas sûr que ces néologismes fassent suffisamment sens pour s’imposer à l’avenir.
Attardons-nous enfin sur le chapitre « Politique ». Un thème forcément central et où les positions de l’auteur son attendues. Après avoir rappelé la critique faite aux anarchistes par Bookchin sur l’opposition de principe face au pouvoir, avec pour contre-proposition de postuler la juste répartition de celui-ci, Sauvêtre appuie sur l’identité républicaine du confédéralisme promu par les écologistes sociaux. Bookchin place résolument son municipalisme libertaire dans le giron d’une constitution et de lois. Un élément qui explique les particularités de la théorie de Bookchin et sa mise en retrait du mouvement anarchiste. A cheval entre plusieurs traditions idéologiques, il a donné la primauté à l’auto-gouvernement rappelle Sauvêtre plutôt qu’à l’absence de gouvernement. La question de la constitution pourrait néanmoins aujourd’hui est confrontée aux recherches modernes.1
Notons que plusieurs pages sont dédiées à répondre aux potentielles limites du système communaliste. Comment faire pour qu’une confédération de communes ne recrée pas un fédéralisme étatique ? Comment gérer les possibles dissensions entre communes ? L’auteur rappelle l’importance donnée par Bookchin à la transparence, au mandat impératif, au besoin pour les personnes mandatées de rendre des comptes. L’absence d’indépendance des exécutants doit permettre de prévenir les tendances centralisatrices. Enfin, le cadre fédéraliste doit disposer de moyen de régler les divergences entre communes. L’accord confédéral doit rester un cadre souple, adaptable, mais contraignant pour les communes qui l’adoptent.
Dans sa conclusion, Pierre Sauvêtre relève un paradoxe de l’échelle politique du communalisme, à garder en tête. A savoir qu’un mouvement communaliste ne peut exister centré sur le seul espace de la commune, et qu’il demande une réflexion au minimum dit l’auteur au niveau de la région. Le communalisme est de fait « confédération » avant d’être « municipal » : « Un mouvement communaliste ne peut donc avoir de chance de succès que s’il est soutenu par une organisation nationale composée de multitude de groupes locaux, qui ont fait de la pratique de la démocratie directe leur savoir-faire politique ; qui sont capables de l’apprendre aux habitants désireux de rejoindre le mouvement communaliste ; et qui, habitués à travailler ensemble, ont vocation de l’exercer de façon confédérale et solidaire avec d’autres communes. Une des leçons de la Commune de 1871 a déjà été, en son temps, qu’une confédération de communes ne saurait être l’émanation d’un soulèvement communal isolé, fut-ce celui d’une grande capitale. » (p.307) Un fait constaté et entendu dans la bouche de bon nombre d’acteurs militants ayant tenté l’aventure de l’autogestion communale ces dernières années.
Murray Bookchin ou l’objectif communocène marque une volonté réelle et bienvenue d’enrichir le corpus d’idée par d’autres valeurs. A la lecture du livre, on ne peut que constater que Pierre Sauvêtre connaît extrêmement bien son sujet. L’ensemble des ouvrages de Bookchin sont mentionnés à un moment ou l’autre, accompagnés d’articles plus confidentiels. C’est un livre érudit qui, comme revers de la médaille, se révèle par moments complexe à la lecture (le chapitre « Politique » fait néanmoins exception et se révèle plus clair et accessible). Ouvrage donc plutôt dévoué à un public universitaire et aux personnes déjà familiarisées avec les principes de l’écologie sociale. Il s’adresse à celles et ceux qui cherchent un approfondissement plus qu’une introduction.
Pierre Sauvêtre, Murray Bookchin ou l’objectif communocène, écologie sociale et libération planétaire, éd. L’Atelier, 2024, 320 pages.
1Voir notamment l’ouvrage récent de Justine Fontaine qui fait passablement parler de lui aujourd’hui : La constitution au XXIe siècle, histoire d’un fétiche social, éd. Amsterdam, 2024.