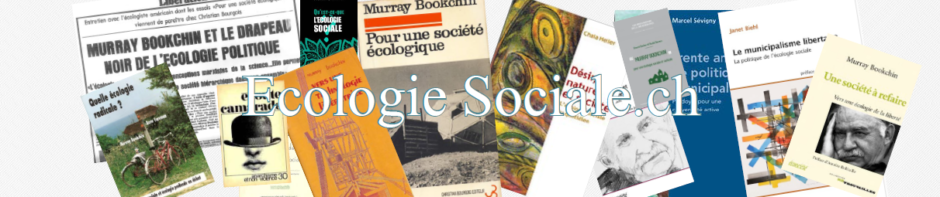Nous apprenons avec tristesse le décès, le 3 mai 2024 et jour de son 90ème anniversaire, de Daniel Blanchard.
Poète et écrivain talentueux, traducteur, introducteur (et ami) de Murray Bookchin en France, Daniel Blanchard était un amoureux de la montagne et de la poésie autant que des luttes pour un monde plus juste. Plus humain également. L’écologie sociale lui devait la parution de Pour une société écologique en 1976, aux éditions Christian Bourgois, longtemps resté comme l’unique recueil francophone disponible en France, avec un choix de textes très pertinents. Daniel Blanchard avait encore signé, il y a 5 ans, la préface du livre Pouvoir de détruire, pouvoir de créer. L’an dernier paraissait Vie sur les crêtes, son autobiographie et ultime ouvrage.

Ils sont bien rares celles et ceux qui savent manier autant le verbe que l’intelligence du propos, la forme et le fond. Cette autobiographie, comme beaucoup de textes de Daniel Blanchard qui m’ait été donnés de lire, se révèle aussi bien écrite que passionnante. On y vit de l’intérieur son adhésion à l’aventure de Socialisme ou Barbarie, ses liens avec Guy Debord et les situationnistes, ou comment il a rencontré Murray Bookchin à Paris, un certain mois de mai 1968…
Les curieux de l’histoire de l’écologie sociale liront particulièrement les chapitre IV et V, relatant la rencontre entre Daniel Blanchard et sa femme, Helen Arnold, avec Bookchin, ainsi que les diffusion des textes traduits de Bookchin. Leur rencontre, loin d’être anodine, a lieu fin mai 1968, quand Bookchin fait le voyage à Paris pour découvrir et assister de lui-même à l’élan révolutionnaire qui s’y tient. Helen lui sert alors d’interprète, marquant le début d’une longue relation d’amitié avec la famille de Bookchin. Plus tard, Daniel et Helen viendront habiter pendant un an dans le Vermont, dans la communauté dans laquelle Bookchin vivait alors, après son départ de New York.
Revenant sur ses souvenirs, reprenant visiblement souvenirs conservés dans des notes et journaux, Daniel Blanchard décrit de l’intérieur les communautés populaire qui fleurissaient alors dans le Vermont leur tentatives de se libérer des codes et de fonctionner en autonomie. Et les difficultés rencontrées notamment.

« C’était là le principal obstacle auquel se heurtait Murray lorsqu’il réunissait quelques people, les plus ouverts, pour leur exposer les rudiments de sa critique radicale du capitalisme et son projet de société écologique et libertaire, une fédération de communes décentralisées et autogérées démocratiquement, qu’ils pourraient, qu’ils devraient commencer à mettre en œuvre ici et maintenant. Ils se disaient certes d’accord en principe, mais à aucun moment, à ma connaissance, ne s’est constitué, entre toutes ces communes qui se voulaient en rupture avec l’État américain et la société de classes, ne serait-ce que l’embryon d’une collectivité politique, qui se serait déterminée démocratiquement, à la base, sur des questions d’intérêt commun. Symptomatique de l’esprit étroitement pragmatique hérité de la culture dominante, le fait que les seuls organes d’intérêt commun qu’ils aient créés, c’était des services : food coop, free clinic, free school, People’s yellow pages… » (p.156)
Au-delà du récit de vie personnel, c’est le parcours de fondation d’une pensée militante que l’on découvre, marquée par des événements forts, comme l’obligation de se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale, avec son père actif dans un réseau de Résistants, autant que des personnalités marquantes : Castoriadis, Debord, Bookchin, dont il a partagé le chemin. Et, plus rare sans doute, l’amitié. On en retire beaucoup à la lecture de ce texte, dont on apprécie le message sensible, jugeant sans accuser, avec une sensibilité bienvenue et assez rare dans ce milieu. Loin des polémiques, une volonté de comprendre, de progresser, de mettre en avant la pluralité des pensées et, surtout, une vision humaine, du cœur, sur toutes ces figures autant que sur son propre parcours militant, nous faisant partager tout ce qu’il a retiré de ce « chemin sur les crêtes ».
On citera, issue des dernières pages, cette revendication réaffirmée : « Seule une société d’individus égaux en droit et en condition réelle, et donc également responsables, peut faire face à une crise écologique à la fois planétaire et infiniment diversifiée dans ses manifestations – aussi diversifiée que le sont les habitats humains. Si une démocratie authentique, c’est-à-dire directe et ancrée localement, n’est pas en soi la solution, c’est en tout cas la condition pour que soient recherchées et éventuellement trouvées et mises en œuvre l’infinie diversité des solutions que requiert une crise écologique infiniment variée. » (p.197)
Ce livre est un coup de cœur et une tristesse à la fois. Le récit restera, mais les mots, qui lui étaient chers, se sont envolés…