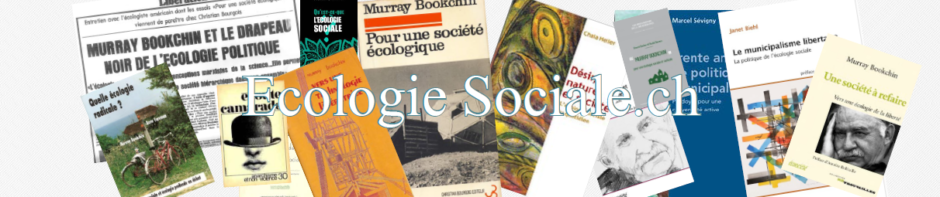Éditorial Harbinger, vol. 3, été 2024
Pour le texte original anglais, cliquez ici.
Ce numéro de Harbinger est consacré à l’exploration de ce que l’on pourrait appeler les « hérésies » de l’écologie sociale – de nouvelles perspectives qui critiquent, remettent en question ou repensent les « orthodoxies » dominantes et s’attaquent à certaines vaches sacrées de notre communauté politique. À cette fin, nous avons recherché des perspectives qui, nous l’espérons, susciteront un débat productif et bousculeront nos idées reçues. Une grande partie du projet politique et intellectuel de Murray Bookchin visait à analyser, modifier et transcender les traditions et les penseurs et penseuses dont les idées, selon lui, avaient été rendues inexactes par l’évolution des circonstances sociales. Alors qu’il critiquait intelligemment la gauche qui s’accrochait à des idées ainsi qu’à des stratégies dépassées qui ne tenaient pas compte de circonstances historiques radicalement différentes, nous devons faire de même. Nous cherchons à poursuivre ici cette tradition de théorie critique autoréflexive et de critique intrinsèque. Notre objectif n’est pas de ressasser de vieux débats ou de tracer des limites à ne pas dépasser, mais plutôt d’encourager de nouvelles discussions productives pour garantir que l’écologie sociale reste politiquement et théoriquement pertinente, dynamique et capable de s’adapter à un monde en constante évolution.
Toutes les idées politiques sont confrontées à une tension entre la cohérence idéologique et l’évolution, la stabilité et le changement. Quelles sont les idées fondamentales qui doivent rester cohérentes, et quelles sont celles qui doivent être mises à jour en raison de nouveaux développements historiques ou théoriques ? Bien que l’écologie sociale ait été développée par de nombreuses personnes et de nombreux mouvements dans des contextes et des lieux variés, elle reste fortement identifiée à son théoricien fondateur, Murray Bookchin. En tant que penseur profondément systémique, Bookchin mettait fortement l’accent sur la cohérence idéologique et défendait vigoureusement ses idées – et souvent de manière polémique. La centralité de sa contribution intellectuelle individuelle à la tradition de l’écologie sociale a parfois donné l’impression qu’il s’agissait d’une orthodoxie, d’une vision politique du monde fermée, liée au travail d’un seul homme. En conséquence, des débats – et parfois des scissions – ont périodiquement émergé autour de l’intégration de nouvelles idées au sein de l’écologie sociale. Bien entendu, cette dynamique n’est pas propre à l’écologie sociale, elle caractérise une longue lignée de mouvements religieux, intellectuels et politiques.
Un recueil incomplet des débats passés se devrait d’inclure le clivage des années 1980 entre l’écologie sociale et l’écologie profonde concernant la nature de la nature, qui a donné lieu à de riches discussions sur le biocentrisme, l’anthropocentrisme, le monisme, le dualisme, l’évolution et le naturalisme dialectique. Avec la montée en puissance du post-structuralisme et de la politique identitaire dans les années 80 et 90, les forts engagements de Bookchin en faveur de la laïcité et des Lumières l’ont amené à entrer de plus en plus intensément en conflit avec les défenseurs des écospiritualités, des cosmologies indigènes et des nationalismes des opprimés. Dans les années 1990, la critique de Bookchin sur le « gouffre infranchissable » séparant l’anarchisme social de l’anarchisme individualiste « de style de vie », y compris l’anarcho-primitivisme et l’« anarchie post-gauche », est devenue une source de contestation féroce reflétant des divergences fondamentales sur l’importance de l’organisation politique, l’héritage de la gauche historique et la politique du mouvement social par rapport à la contre-culture et aux changements de style de vie individuels. Lorsque Bookchin a fini par abandonner l’anarchisme en 1999, son plaidoyer en faveur du municipalisme libertaire et surtout de la participation aux élections locales a suscité de vifs désaccords avec ses anciens camarades anarchistes. Du côté de la gauche traditionnelle, les marxistes et les sociaux-démocrates ont critiqué le rejet de l’État par l’écologie sociale et son engagement concomitant en faveur de la démocratie directe, ainsi que la valorisation par Bookchin d’un intérêt humain général plutôt que d’intérêts politiques de classe ou d’autres intérêts particularistes. Ces questions se recoupent souvent avec des préoccupations stratégiques et tactiques, telles que la signification de la « politique préfigurative » par rapport à la démocratie directe, la prise de décision par consensus et les questions d’échelle soulevées par la notion de confédéralisme. Dans les années 2000, les étudiants du campus Maple Hill de l’Institut, dans le Vermont, ont débattu de la compatibilité de l’écologie sociale avec l’anti-naturalisme post-structuraliste et la politique de genre issue des travaux de Judith Butler, ainsi que de l’utilité de concepts post-marxistes tels que la « multitude » de Hardt et Negri. Des discussions récurrentes ont eu lieu sur la question de savoir jusqu’où étendre la critique de la hiérarchie, sur la fermeté de la ligne de démarcation entre la première et la seconde nature et sur les conflits connexes concernant l’anthropocentrisme, ainsi que sur les conflits entre celles et ceux qui défendent une position omnivore écologique et d’autres défendant la perspective végétalienne ou de libération totale.
Aussi importants que soient ces débats spécifiques, ils mettent en évidence des questions encore plus fondamentales telles que : dans quelle mesure l’écologie sociale est-elle ouverte aux nouvelles idées ? Lesquelles et pourquoi ? Dans quelle mesure peut-on et doit-on intégrer des idées provenant d’autres traditions ? Qu’est-ce qui constitue une incompatibilité fondamentale ? Quelles contradictions ou tensions existent déjà au sein de l’écologie sociale ? Comment les idées politiques peuvent-elles naviguer entre le changement et la stabilité ? Une tradition qui n’évolue pas devient stagnante et dépassée. En revanche, une tradition qui change trop rapidement devient incohérente ou se contente de suivre les dernières modes politiques ou intellectuelles. Quelles sont les transformations historiques les plus urgentes et les questions émergentes qui nécessitent une nouvelle réflexion dans une perspective sociale et écologique ?
Pour ce numéro, nous avons rassemblé des textes qui s’engagent de manière critique et substantielle sur des aspects essentiels de la vision théorique ou politique du monde de l’écologie sociale. Nous avons essayé de mettre en lumière ce qui pourrait être considéré comme les maillons faibles de l’écologie sociale, les idées qui ont besoin d’être mises à jour ou corrigées, ou qui pourraient être considérées comme irrécupérables d’un point de vue théorique ou stratégique. Nous espérons ainsi explorer les autres traditions politiques dont l’écologie sociale pourrait s’inspirer, et pourquoi, et inversement, quelles vaches sacrées devraient rester sacrées.
Nous ne nous attendons pas à ce que celles et ceux qui recherchent une société écologique et non hiérarchique doivent forcément recevoir les mêmes réponses à ces questions. Dans cet esprit, nous ne sommes certainement pas d’accord entre nous avec tout ce qui figure dans les textes suivants ; en fait, nous sommes même souvent en désaccord profond avec les positions et les arguments avancés. Mais nous pensons qu’ils posent des questions intéressantes ou stimulantes qui, à tout le moins, devraient susciter une réflexion sérieuse au sein du mouvement de l’écologie sociale. Nous espérons que ces huit textes inciteront les lecteurs à répondre aux revendications et aux critiques formulées ici, afin que nous puissions poursuivre cet échange au sein de nos mouvements et dans les numéros à venir.
Le texte de Marco Rossaire Rossi « Prospérité, urbanité et conscience écologique » présente un argument socio-écologique contre la décroissance, ancré dans la notion de post-rareté. Il affirme qu’ « une planète écologiquement durable ne dépend pas d’une décroissance de l’économie mondiale, mais tout le contraire. Pour que l’humanité parvienne à une conscience écologique universelle, il est nécessaire de rechercher une augmentation rapide de la croissance économique et d’amener la population mondiale à un état de post-rareté, de sorte que la grande majorité de la population mondiale puisse consacrer du temps et des ressources aux préoccupations écologiques ». La solution à notre crise planétaire, selon Rossi, n’est pas le renversement de la modernité urbaine, mais sa pleine utilisation, basée sur une planification rationnelle et démocratique.
La contribution de Blair Taylor, co-éditeur de Harbinger, intitulée « Résonances hérétiques : Historiciser l’écologie social dans une époque néo-libérale », veut contextualiser le projet intellectuel et politique de Bookchin par rapport à la situation historique de la fin du fordisme dans lequel il a été écrit, afin de faire valoir que nombre de ses idées fondamentales visent deux cibles – le capitalisme fordiste dirigé par l’État et le marxisme-léninisme de la nouvelle gauche – qui n’existent plus, ce qui rend certains éléments de sa critique sociale moins critiques aujourd’hui. Taylor suggère que le concept clé de hiérarchie de Bookchin suppose une conceptualisation spatialisée et personnifiée du pouvoir – plaçant au centre la verticalité et les « relations de commandement et d’obéissance » – qui, au bout du compte, la rend inadaptée aux modes de pouvoir quasi-horizontaux et auto-activés qui caractérisent le capitalisme contemporain, tandis que son alternative politique de décentralisation, d’auto-activation démocratique et de « moralisation » de l’économie présente des résonances troublantes avec certains aspects de la critique néolibérale du capitalisme fordiste dirigé par l’État.
Dans « L’écologie sociale après l’effondrement de l’hégémonie occidentale », Metin Guven affirme que le cadre théorique de l’écologie sociale est marqué, en grande partie du moins, par son développement dans le contexte historique de l’hégémonie américaine et ouest-européenne. S’appuyant sur la théorie des systèmes mondiaux, Guven suggère que cette hégémonie est en train de s’éroder et qu’un nouvel ordre mondial très différent est en train d’émerger, un processus qui exige une nouvelle analyse de la part de l’écologie sociale si elle veut être en mesure de parler du nouveau monde dans lequel nous vivons.
L’article de Jake Fremantle intitulé « De l’ambivalence à la profanation : résister à l’idéal dogmatique de la communauté » met en garde contre l’ambivalence politique du concept de « communauté ». S’appuyant sur des penseurs marxistes et post-structuralistes, Fremantle suggère que la communauté peut facilement devenir un concept réifié et excluant, un concept qui peut tout aussi bien être mobilisé pour sauver le capitalisme plutôt que de le combattre. Si le cadre « communautaire » offre certains avantages politiques, il présente également des risques : cooptation capitaliste, nouvelles formes de privation des droits ou interdiction involontaire de l’émergence de nouvelles formes de communauté à l’avenir.
« L’agisme dans la réflexion sur l’eugénisme » de Zach Whitworth examine la relation historique de la gauche avec le mouvement eugénique, en essayant de distinguer les impulsions racistes et incapacitantes de celles qui cherchent à améliorer la condition humaine en éliminant l’« irrationnel » dans la société. Le texte explore les parallèles gênants entre l’accent mis sur l’orientation consciente de l’évolution par des penseurs eugénistes tels que Galton, Ellis et Haeckel et les notions similaires que l’on retrouve dans la notion de troisième nature de Bookchin et sa distinction dialectique entre la simple réalité et le rationnel. Face aux penseurs eugénistes qui cherchaient à éliminer le handicap, Whitworth reprend Kropotkine pour soutenir que la thèse de la gérontocratie de Bookchin – implicitement gouvernée par les personnes handicapées par l’âge qui cherchent à se protéger en institutionnalisant leur pouvoir social – offre une perspective pour réfléchir à la manière de dépasser une société organisée dédiée à nous rendre toutes et tous handicapés.
Dans le premier article d’une série prévue sur la science de la « seconde nature », Mason Herson-Hord remet en question le principe philosophique de base de l’écologie sociale selon lequel ce que nous appelons la seconde nature (l’émergence historique de la société à partir de l’évolution biologique) se limite aux êtres humains. Son essai passe en revue les travaux scientifiques contemporains sur l’apprentissage social, la coévolution gène/culture et l’information au sujet des cultures auprès d’une grande variété d’autres espèces animales. Trois études de cas détaillées (éléphants d’Afrique, orques et cachalots) sont utilisées pour illustrer le développement social en cours dans certaines sociétés animales. Selon lui, l’écologie sociale a avancé des affirmations sur notre monde qui ne sont tout simplement plus défendables sur le plan scientifique et qui nécessitent une révision philosophique importante afin de reconnaître la « seconde nature au-delà de l’humain ».
Dans « Toujours nager en amont : Mon voyage social écologique », Grace Gershuny revient sur son passage à l’Institut d’écologie sociale, à la fois source de son développement politique et intellectuel et frein à son développement spirituel. Cet essai personnel aborde les tensions entre la rationalité et les modes de connaissance non rationnels, en s’attaquant à l’insistance de Bookchin sur le maintien de l’héritage des Lumières européennes. Gershuny examine également la priorité accordée par Bookchin à l’action du mouvement social par rapport à « l’action intérieure » de la réflexion spirituelle, et souligne que son travail au sein d’autres organisations a montré un autre type d’équilibre entre ces deux pôles.
Enfin, nous avons transcrit un dialogue entre Chaia Heller et Peter Staudenmaier, qui revisite les débats passés au sein de l’écologie sociale sur la viabilité philosophique du naturalisme dialectique. Murray Bookchin pensait qu’il était possible d’extraire une éthique objective de l’histoire naturelle, en tant que fondement politique rationnel en opposition aux dangers posés par le relativisme éthique. Ces deux membres de longue date du corps enseignant de l’ISE reviennent sur ces débats, réfléchissent aux enjeux d’alors et d’aujourd’hui et examinent comment leur pensée a évolué au cours des décennies suivantes, au fur et à mesure que la science de l’évolution évoluaient et le monde avec elles.
Nous espérons que ce numéro suscitera des débats vigoureux et des réponses divergentes de la part des lecteurs et lectrices, afin d’approfondir la réflexion sur cette pensée et de renforcer notre capacité intellectuelle à la critiquer autant qu’à la défendre. Pour une écologie sociale qui grandit !
– Les éditeurs d’Harbinger : A Journal of Social Ecology